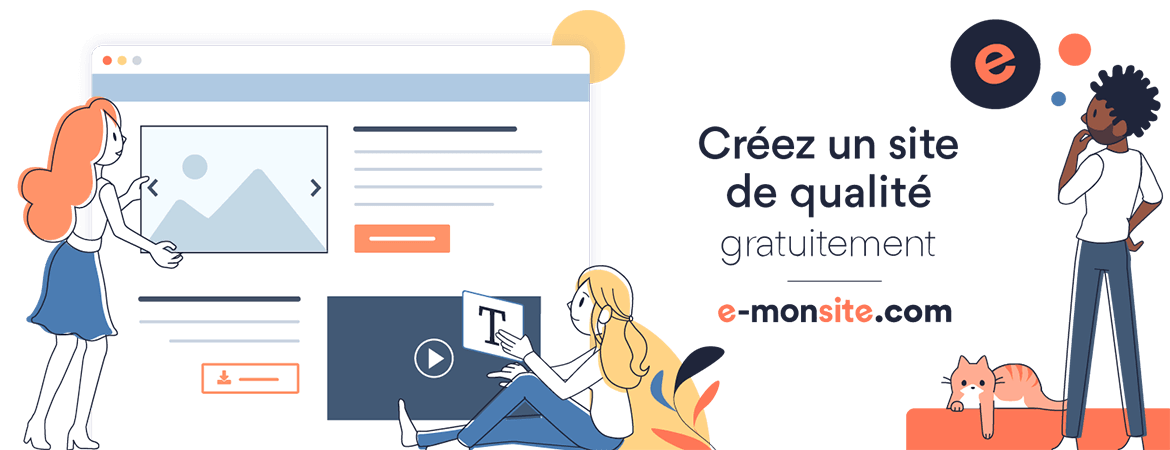Parcours d'une renaissance
Fin 2011, j'ai changé de vie pour apprendre la peinture et le dessin alors que je ne les avais jamais pratiqués auparavant. Mon itinéraire, sur la route de l'Art, est ponctué d'articles dans lesquels je livre mes découvertes, sensations et émotions.
Près de 300 articles viennent illustrer les étapes de mon parcours, de l'apprentissage des techniques en atelier à la prise de conscience de mon identité artistique. Cela s'apparente à l'apprentissage de l'écriture jusqu'à la découverte de ce que sera la signature qui nous identifie pour la vie.
En mars 2017, j'ai décidé de revisiter mon parcours à partir des articles les plus significatifs de ma progression vers une posture artistique.
-
Le luxe de l'insouciance
- Par
- Le 23/03/2017
- Dans Parcours d'une renaissance
- 0 commentaire

Diamant mandarin - gouache sur papier - janvier 2011
« Apprendre à observer et maîtriser les techniques de manière à pouvoir entamer dans de bonnes conditions une recherche personnelle créative et pertinente. Savoir utiliser la technique comme un outil au service de sa sensibilité et de sa créativité et non comme une finalité ». Tel est l’objectif précisé dans la Convention de Formation Professionnelle intitulée « Formation dessin, graphisme et couleur, peinture acrylique » que j’ai signée dans le cadre de mon DIF. Même s’il s’agit d’une formation « professionnelle » (DIF oblige), il n’est pas question pour moi de la transformer en projet professionnel.
Je débute le 13 septembre, à la fréquence d’une séance hebdomadaire de trois heures, le lundi après-midi. Je retrouve dans l’organisation proposée par l’atelier ce que j’avais apprécié lors des séances de peinture vécues en entreprise : Delphine accompagne ses élèves à leur rythme. Pas d’objectif à réaliser, pas de validation d’acquis. Les étapes sont définies en fonction des progrès, des sensations et des envies. Cette situation est nouvelle pour moi. Jusqu’ici, j’ai toujours mis dans ce que j’ai entrepris un objectif à atteindre ou un résultat à obtenir.
Quand j’étais Scout, dans les années 60-70, le diplôme avait la forme des badges et insignes qui font la fierté du Louveteau qui les a obtenus, par son habileté et son courage, et l’admiration de celui qui n’a pas encore fait sa Promesse. J’avais pu en glaner quelques-uns mais mon rêve était qu’ils recouvrent la manche gauche de mon pull marine, comme c’était le cas pour ceux que je considérais comme des « costauds ».
À la même époque, j’avais fait du judo, sans grande motivation. Ce sport était censé développer la force et la maîtrise de soi. J’y voyais surtout la possibilité d’apprendre à me défendre. Pour ce faire, il fallait être mis en situation, c’est-à-dire… se faire attaquer, ce que je redoutais. Chuter, faire chuter, ce n’était pas ma tasse de thé. Et puis je n’aimais pas l’odeur du tatami sur lequel j’avais trop souvent le nez collé. Pourtant je m’efforçais de le faire correctement pour obtenir, avec fierté mais sans conviction, les ceintures jaunes, oranges puis vertes. Plus on grimpait dans l’échelle des ceintures, plus les combats étaient rudes et les affrontements pénibles.
En 1970, je me suis essayé au sport d’équipe avec le hand-ball. Un copain de lycée, François B., m’avait proposé de le rejoindre dans son club. Il faisait figure de rebelle dans la classe, n’ayant peur de rien et surtout pas de l’autorité. Il jouait de la clarinette et sa mère était directrice de casting dans une agence de pub, ce qui m’avait permis de faire un essai devant la caméra pour une pub qui n’a jamais vu le jour. Sur une photo du tournage, je me souviens regarder François avec un air complice, chacun de nous ayant un gros cigare à la main. Le côtoyer c’était créer la possibilité du transgressif et de l’interdit. Faire du hand-ball avec lui c’était entrer dans son cercle et prendre une part de cette rébellion qui me fascinait. Sur le terrain, François était un avant-centre perceur de défense, et moi je n’ai jamais marqué un but. Sans cette consécration, je n’existais pas. Lors des matches, j’étais plus souvent sur le banc que sur le terrain. Mon engagement n’a duré qu’une saison et j’ai considéré que les sports collectifs n’étaient pas faits pour moi.
Je suis arrivé à l’escalade deux ans plus tard, à seize ans, en répondant à la sollicitation d’un camarade qui m’avait proposé de rejoindre en vélo la maison familiale dans les Alpes. Nous nous sommes entraînés dans la forêt de Fontainebleau où il pratiquait régulièrement la varappe. J’ai été convaincu par cet exercice entre terre et ciel, défi lancé à la gravité. En escalade, les difficultés sont évaluées au moyen d’une cotation qui va de F (facile) à ABO (abominable). En gravir les échelons était un but et, même si rien ne m’obligeait à le faire, je mettais toujours la barre plus haut, la sanction de la chute me permettant d’évaluer si j’étais ou non au niveau.
En pratiquant ces activités, il y avait toujours pour moi un objectif précis. Si je n’y arrivais pas, si je ne décrochais pas le Graal, je n’étais pas bon, pas à la hauteur. Aujourd’hui, j’ai peu de repères avec la peinture et le dessin. Ma seule motivation est d’apprendre. Quarante années sont passées et j’ai moins besoin qu’autrefois de prouver aux autres que « je suis capable ». Tout se passe entre moi et moi. Plus de chef de patrouille à qui obéir, plus de prof de sport qui sanctionne, plus d’entraîneur qui sélectionne. C’est jouissif de pouvoir arriver aller en cours sans devoir justifier d’un travail accompli. Le travail n’est pas un problème mais, pour la première fois de ma vie, je me sens libre de faire ou de ne pas faire. Avec cette formation, je découvre le luxe de l’insouciance. C’est bon la légèreté !
Le lundi 13 septembre 2010, jour de mon premier cours, je me sens comme un premier jour d’école : un peu d’administratif, une liste de matériel à acheter et une entrée en matière ludique. J’entre dans le vif du sujet avec une nature morte à dessiner au crayon noir. Rapidement, je passe du ludique au problématique. Je n’arrive pas à reproduire avec précision ce que je vois. Dire que le dessin est imprécis est un euphémisme. Delphine a l’œil aiguisé pour repérer quand un élève est en difficulté. Mais, en bon professeur et en pratiquante assidue du croquis, elle sait que sans se trouver confronté aux problèmes de la perspective et des proportions, de la lumière et de l’ombre, du choix de l’outil et du support adéquats, l’élève n’a aucune chance de parvenir à l’autonomie et l’enseignement du professeur de s’ancrer sur du vécu.

Beauté colorée – pastel - mars 2011
Toujours bienveillante, jamais complaisante. Ces qualificatifs traduisent la façon dont je vis l’accompagnement de Delphine. Nous ne restons pas plus de deux ou trois séances sur un media : après le crayon à mine de graphite et les natures mortes simples (un pot, une cruche, un fruit), je travaille l’encre de chine avec des outils divers (pinceau, plume, bambou taillé ou calame) pour des modèles plus complexes (batteur à œufs, mini cactus et « Chucky », l’ours en peluche). Les 3 heures passées en atelier ne rassasient pas mon envie d’apprendre, à moins que ce ne soit mon besoin de réussir. Les outils, comme les modèles, sont simples, facilement transportables. Tout objet devient matière à dessin, prétexte à dessiner : à la maison, ce sont la table à repasser, la souris de mon ordinateur, un téléphone portable et les verres.
J’aime tracer l’ovale de la partie supérieure d’un verre. Je trouve ce mouvement agréable à faire. Je détecte en écrivant ces lignes que si l’ovale me plaît c’est parce qu’il supporte l’imprécision. Un rond, s’il n’est pas parfait, n’en est plus un. Une ligne droite ne mérite pas ce qualificatif si elle n’est absolument rectiligne. Dans ces deux exemples, la moindre imperfection se sent si elle ne se voit pas. Avec l’ovale, je trouve que c’est supportable. Ça permet de travailler avec moins de pression. Dessiner des verres à eau, des verres à pied, des bouteilles est un de mes défis favoris.
Après l’exploration du crayon noir et de l’encre, je termine le dernier trimestre 2010 avec de la couleur : les crayons, puis le pastel et, enfin, la peinture avec la gouache. Aux natures mortes viennent s’ajouter les portraits et les animaux. Je travaille aussi les drapés.
Chaque séance est l’opportunité d’un challenge dans lequel je m’investis à fond, en quête de l’approbation de Delphine, toujours encourageante, distillant des conseils pertinents au moment opportun.
Je garde de cette période septembre-décembre 2010 un souvenir joyeux. Ma préoccupation de trouver une activité professionnelle reste présente mais passe au second plan. Le présent est occupé à mettre en pratique les enseignements reçus à l’atelier. Qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou qu’il vente, je savoure sur mon vélo les 15 kilomètres que je parcours chaque semaine pour rejoindre Chelles d’où je repars à chaque fois avec la satisfaction d’avoir appris quelque chose de nouveau et qui renforce ma confiance en ma capacité d’avancer.
Rien n’est simple mais j’ai le goût de l’effort, alors tout va bien ! Je jouis de ma situation comme je n’ai pas le souvenir de l’avoir déjà vécu.
-
Le jour du déclic
- Par
- Le 17/03/2017
- 0 commentaire
Lundi 30 août 2010. Je suis en congés depuis… 3 mois. Nous sommes en fin d’été et, ce matin, je n’ai pas repris le travail comme ce fut le cas ces 32 dernières années. Et pour cause : c’est aujourd’hui le dernier jour de mon préavis de licenciement.
Je suis inclus dans ce que l’on appelle un PSE : Plan de Sauvegarde de l’Emploi, ce qui signifie paradoxalement que je perds le mien. L’environnement économique dans lequel évolue l’entreprise qui m’employait a imposé la suppression de plusieurs centaines de postes. Jusqu’ici, j’ai traversé sept PSE et c’est le troisième dans lequel mon poste est supprimé. Par deux fois, j’avais pu me repositionner dans l’entreprise à un poste qui correspondait à ce que je savais et voulais faire.Là, c’est différent. Mon poste est une nouvelle fois supprimé mais il n’y a pas dans le nouvel organigramme de place qui corresponde à mes compétences. Au sein de la Division des Ventes, j’étais depuis 25 ans un « homme de l’ombre », de ceux qui sont là pour mettre de l’huile dans les rouages, qui font tout pour que ce qui est indispensable et qui paraît techniquement impossible trouve une solution. Je suis un généraliste, qui connaît les rouages de l’entreprise, qui sait toujours trouver la bonne personne au bon moment et qui a pris avec lui une rallonge électrique ou un couteau suisse quand personne n’avait imaginé en avoir besoin.Un de mes patrons, à qui j’avais posé la question « comment me vois-tu dans l’entreprise ? », avait répondu « comme un problem solver ». Et ce monde qui fonctionne à court terme n’a plus besoin de ces profils qui créent du lien dans l’entreprise. Chacun sa spécialité, sa mission et ses responsabilités. Le lien informatique fera le reste.La pré-retraite représente pour beaucoup une fabuleuse opportunité donnant à celui qui y a droit la possibilité d’être payé (par l’entreprise) jusqu’à la retraite sans avoir à y travailler. Il me manque 45 jours pour y avoir accès. Le commentaire que j’entends le plus souvent est que je devrais faire un procès à mes parents pour ne pas m’avoir conçu sept semaines plus tôt. Je sais depuis plusieurs mois que je ne peux y prétendre et ça ne sert à rien de s’apitoyer sur mon sort, même si ceux à qui je le dis paraissent désolés pour moi.Mes vingt-cinq ans d’ancienneté me permettent de partir dans des conditions financières acceptables. J’ai fait mes comptes et finalement décidé de partir de l’entreprise, sans projet particulier, vers un inconnu que je suis convaincu d’apprivoiser en quelques semaines ou, au pire, quelques mois.Depuis mon départ physique de l’entreprise, trois mois plus tôt, j’ai exploré plusieurs pistes de reconversion qui se sont toutes terminées en impasse. La première m’a été procurée par la rencontre improbable d’un ancien collègue perdu de vue depuis 10 ans et devenu chef d’entreprise. Il entrait dans un restaurant lyonnais où j’étais en train de faire connaissance pour la première fois avec un « tablier de sapeur ». Lorsque j’ai évoqué ma situation, il m’a aussitôt proposé une mission dans un domaine que j’affectionne (la remise en ordre d’un système d’information). Mes premiers pas de consultant m’ont très vite fait ressentir que je ne voulais plus remettre les pieds dans un lieu que j’avais décidé de quitter : l’entreprise broyeuse et anxiogène qui veut colmater des plaies béantes avec du sparadrap.J’ai étudié d’autres pistes qui demandaient une formation diplômante : gestionnaire de patrimoine, naturopathe, conseiller en prévention des risques psychosociaux… Mais à 54 ans, je n’ai pas eu la force de reprendre des études.Dans ma recherche, je suis accompagné par une société dont la mission est de m’aider à définir un projet. Après une demi-douzaine de pistes explorées sans succès, je suis une fois encore revenu au point de départ. Je vis cette situation avec difficulté. Mes envies sont éteintes, mon avenir est inexistant. Je ne suis pas dos au mur ; je suis face à lui, incapable de me projeter.Je me replonge dans mon dossier de licenciement pour voir où j’en suis concernant mes Droits Individuels Formation (DIF). Accumulés au cours de mes années de travail, ces droits me permettent de mettre en œuvre un projet de formation. STUPEUR ! Je constate que j’ai jusqu’à la fin de mon préavis, c’est à dire demain, pour les faire valoir en présentant un dossier recevable à mon entreprise, faute de quoi ces droits seront perdus.Au milieu du marasme et de mon manque d’envie je dois absolument trouver une formation motivante pour moi et acceptable par l’entreprise : apprendre un langage de programmation ou comment construire un site internet ? Je cherche, trouve, lis et me désespère. Si j’avais été motivé par ces sujets, je les aurais explorés depuis longtemps…Soudain une étincelle : et si j’apprenais à peindre ? Deux ans plus tôt, en 2008, j’avais été époustouflé par une exposition des peintures réalisées par les élèves du cours subventionné par le Comité d’Entreprise. « Les barques » de Van Gogh côtoyaient « La jeune fille à la perle » de Vermeer et « La pie » de Monet.J’avais intégré cet atelier de deux heures hebdomadaires se tenant dans une salle de réunion où nous étions 6 ou 7 à tenter de reproduire des toiles de maîtres. Chacun à notre rythme, nous étions accompagnés par un artiste passionné qui, avant de jeter ses élèves dans le grand bain de la copie, leur faisaient travailler les ombres à partir du dessin d’une pomme. Il m’avait fait acheter quelques tubes de peinture à l’huile et m’avait fait « patouiller » avec une spatule à partir de noisettes de couleurs posées sur une feuille de papier à dessin noir. Les gestes que j’avais faits faisaient se mélanger les couleurs pour en créer de nouvelles avec des dégradés que je trouvais superbes. J’avais été marqué par cette expérience et étonné de l’émotion positive qu’elle avait provoquée.Pour moi, ce n’était pas ça, peindre. Il ne s’agissait que d’un exercice qui me permettrait, je l’espérais, d’atteindre le Graal : copier les maîtres pour disposer, à la maison, de chefs-d’œuvres que je pourrais admirer et montrer à loisirs, fier de pouvoir dire « c’est moi qui l’ai fait ! ». C’était un défi dont je me sentais incapable pour l’heure. Mais n’est-ce pas cela l’essence du défi ?
Il m’avait fait acheter quelques tubes de peinture à l’huile et m’avait fait « patouiller » avec une spatule à partir de noisettes de couleurs posées sur une feuille de papier à dessin noir. Les gestes que j’avais faits faisaient se mélanger les couleurs pour en créer de nouvelles avec des dégradés que je trouvais superbes. J’avais été marqué par cette expérience et étonné de l’émotion positive qu’elle avait provoquée.Pour moi, ce n’était pas ça, peindre. Il ne s’agissait que d’un exercice qui me permettrait, je l’espérais, d’atteindre le Graal : copier les maîtres pour disposer, à la maison, de chefs-d’œuvres que je pourrais admirer et montrer à loisirs, fier de pouvoir dire « c’est moi qui l’ai fait ! ». C’était un défi dont je me sentais incapable pour l’heure. Mais n’est-ce pas cela l’essence du défi ?"Barbouillage galactique" ou l'art du patouillage
 Dans les semaines qui ont suivi, j’ai copié une première toile (« Portrait d’Armand Roulin » (Le fils du facteur) de Van Gogh). La copie était approximative mais j’étais fier du résultat auquel j’étais parvenu."Portrait d'Armand Roulin" - Huile sur toile - 61x50 - d'après Van Gogh
Dans les semaines qui ont suivi, j’ai copié une première toile (« Portrait d’Armand Roulin » (Le fils du facteur) de Van Gogh). La copie était approximative mais j’étais fier du résultat auquel j’étais parvenu."Portrait d'Armand Roulin" - Huile sur toile - 61x50 - d'après Van Gogh La seconde fut « Persistance de la mémoire » de Dali, demandée par mon fils. Je suivais avec application les indications du professeur, tel l’apprenti cycliste qui dispose de roulettes stabilisatrices."Persistance de la mémoire" - Huile sur toile - d'après Dali
La seconde fut « Persistance de la mémoire » de Dali, demandée par mon fils. Je suivais avec application les indications du professeur, tel l’apprenti cycliste qui dispose de roulettes stabilisatrices."Persistance de la mémoire" - Huile sur toile - d'après Dali Lorsque j’ai commencé la troisième (« La liseuse » de Fragonard, commandée par mon épouse), les cours se sont arrêtés, le Comité d’Entreprise ne souhaitant plus subventionner une activité jugée trop élitiste compte tenu du faible nombre de personnes bénéficiaires.Je me suis retrouvé avec ma « Liseuse » à peine commencée, incapable de poursuivre seul la réalisation de ma copie. L’envie d’y parvenir me torturait mais j’avais trop peur d’abîmer ce qui avait déjà été fait. J’ai mis mon rêve sous un oreiller, préférant les regrets de ne pas poursuivre aux remords d’avoir gâché."La liseuse" en friche, d'après FragonardMais revenons-en à ce 30 août et à l’étincelle qui vient d’apparaître dans le néant lugubre de l’avenir tel que je le vois. Et si j’utilisais mon DIF pour apprendre à peindre ? Il est 14h et je me sens comme un mineur au fond de sa galerie. Il sait qu’un filon se trouve à proximité et sent en même temps l’imminence d’un coup de grisou. Il faut faire vite. La dernière possibilité pour présenter mon dossier est demain matin. J’ai l’après-midi pour trouver comment et où apprendre à peindre. Avec concentration et détermination, je cherche sur internet des ateliers d’arts plastiques susceptibles de m’accueillir.Les premiers ateliers contactés ne savent pas ce qu’est un dossier DIF dont les contraintes administratives demandent une certaine organisation. J’étends donc la recherche et trouve l’Atelier de la Salamandre, à Chelles, qui est administrativement au point pour monter un dossier DIF. Par chance, Delphine, sa propriétaire et animatrice, reprend aujourd’hui et peut me communiquer dans les deux heures une proposition pour cent heures de formation à la découverte des techniques d’arts plastiques.Je contacte la conseillère chargée de m’accompagner dans mon reclassement et de présenter mon dossier DIF. Elle est enthousiaste et le portera demain à mon entreprise. Ouf ! Pour la première fois depuis mon départ, j’envisage un projet avec légèreté. Je suis optimiste sur la validation de mon projet. Le lendemain, mon dossier est accepté et je prendrai mon premier cours dans deux jours. L’aventure artistique commence.
Lorsque j’ai commencé la troisième (« La liseuse » de Fragonard, commandée par mon épouse), les cours se sont arrêtés, le Comité d’Entreprise ne souhaitant plus subventionner une activité jugée trop élitiste compte tenu du faible nombre de personnes bénéficiaires.Je me suis retrouvé avec ma « Liseuse » à peine commencée, incapable de poursuivre seul la réalisation de ma copie. L’envie d’y parvenir me torturait mais j’avais trop peur d’abîmer ce qui avait déjà été fait. J’ai mis mon rêve sous un oreiller, préférant les regrets de ne pas poursuivre aux remords d’avoir gâché."La liseuse" en friche, d'après FragonardMais revenons-en à ce 30 août et à l’étincelle qui vient d’apparaître dans le néant lugubre de l’avenir tel que je le vois. Et si j’utilisais mon DIF pour apprendre à peindre ? Il est 14h et je me sens comme un mineur au fond de sa galerie. Il sait qu’un filon se trouve à proximité et sent en même temps l’imminence d’un coup de grisou. Il faut faire vite. La dernière possibilité pour présenter mon dossier est demain matin. J’ai l’après-midi pour trouver comment et où apprendre à peindre. Avec concentration et détermination, je cherche sur internet des ateliers d’arts plastiques susceptibles de m’accueillir.Les premiers ateliers contactés ne savent pas ce qu’est un dossier DIF dont les contraintes administratives demandent une certaine organisation. J’étends donc la recherche et trouve l’Atelier de la Salamandre, à Chelles, qui est administrativement au point pour monter un dossier DIF. Par chance, Delphine, sa propriétaire et animatrice, reprend aujourd’hui et peut me communiquer dans les deux heures une proposition pour cent heures de formation à la découverte des techniques d’arts plastiques.Je contacte la conseillère chargée de m’accompagner dans mon reclassement et de présenter mon dossier DIF. Elle est enthousiaste et le portera demain à mon entreprise. Ouf ! Pour la première fois depuis mon départ, j’envisage un projet avec légèreté. Je suis optimiste sur la validation de mon projet. Le lendemain, mon dossier est accepté et je prendrai mon premier cours dans deux jours. L’aventure artistique commence.